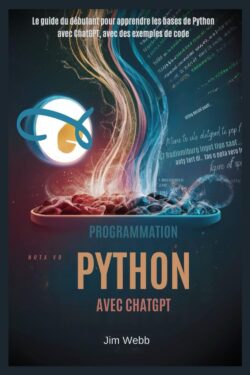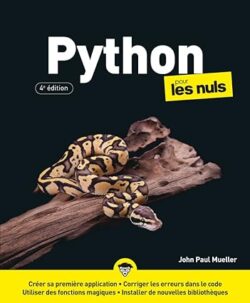1. A propos du cours
- Auteur : Rushed Kanawati (Université Sorbonne Paris Nord – LIPN)
- Type : Support de cours universitaire (Master/Ingénierie), module « CyberSec », Janvier 2023, 127 pages
- Langue : Français
- Licence : Non spécifiée (diffusion pédagogique, droits réservés à l’auteur sauf mention contraire)
2. Courte description du cours
Cours d’introduction à la cybersécurité couvrant l’écosystème des menaces et les mécanismes de défense : modèles d’attaque, pare-feux, détection d’intrusion et authentification. Pensé pour un public Master/Ingénierie, il mêle concepts, méthodes et bonnes pratiques opérationnelles.
2. Longue description du cours
Ce support propose une vue d’ensemble structurée et progressive de la cybersécurité telle qu’elle est enseignée en contexte universitaire (niveau Master/Ingénierie). L’objectif est double : d’une part, donner des repères conceptuels solides pour comprendre les risques, la surface d’attaque et les enjeux de résilience des systèmes d’information ; d’autre part, outiller les apprenants avec des mécanismes techniques concrets de prévention, de détection et de réaction.
Le document s’ouvre sur un panorama introductif qui définit la cybersécurité (confidentialité, intégrité, disponibilité, traçabilité), situe les principaux acteurs (défenseurs, attaquants, utilisateurs, autorités) et précise les notions transversales (politique de sécurité, modèles de menace, hygiène numérique, gouvernance). Cette mise en contexte clarifie les motivations des attaquants, la dynamique des vulnérabilités et le rôle des architectures sécurisées dans la maîtrise des risques.
La section « Attaques » cartographie les familles de menaces : logiciels malveillants (virus, vers, trojans, ransomwares), exploitation de vulnérabilités (buffer overflow, injection, élévation de privilèges), attaques réseau (scans, spoofing, sniffing, MITM), campagnes de phishing et ingénierie sociale, dénis de service (DoS/DDoS), ainsi que les vecteurs modernes liés aux environnements web, mobiles et IoT. Pour chaque catégorie, le cours met en avant la logique d’attaque (pré-requis, étapes, indicateurs) et les leviers de mitigation (réduction de surface, correctifs, segmentation, durcissement).
La partie consacrée aux pare-feux présente les principes du filtrage (stateless vs stateful), la structuration des politiques (règles, chaînes, priorités, stratégies « deny by default »), l’inspection des paquets et des flux, et l’articulation avec des composants adjacents (NAT, proxies, WAF). On y aborde également des patterns d’architecture : zones DMZ, micro-segmentation, filtrage est-ouest, et bonnes pratiques de journalisation et d’audit, essentielles pour relier prévention et détection.
Le module détection d’intrusion expose les approches signature-based (comparaison d’empreintes connues) et anomaly-based (écarts statistiques/comportementaux) au sein des IDS/IPS, ainsi que leur intégration dans une chaîne de supervision (SIEM). Sont discutés : le placement des sondes, la collecte de traces (réseaux, systèmes, applications), la corrélation d’événements, la gestion des faux positifs/negatifs et l’importance des scénarios d’usage (use cases) pour transformer les signaux bruts en alertes actionnables.
Enfin, la section « Authentification » traite des mécanismes d’authentification et de contrôle d’accès : gestion des mots de passe (stockage, politiques, robustesse), authentification multifacteur (2FA/MFA), certificats et PKI, fédération d’identités (SSO), gestion des sessions et principes de Least Privilege et Zero Trust. L’accent est mis sur les risques de dérive (réutilisation, hameçonnage d’identifiants), la mise en place de protections complémentaires (captchas, verrouillages adaptatifs) et l’auditabilité.
Pédagogiquement, le cours alterne concepts, exemples concrets et recommandations opérationnelles. Les apprenants acquièrent ainsi une compréhension « de bout en bout » : du modèle de menace à la mise en place d’une politique de filtrage, de la détection d’un comportement anormal à la réponse graduée, de l’authentification d’un utilisateur à la maîtrise de ses habilitations. L’articulation entre prévention (pare-feux, durcissement), détection (IDS/IPS, SIEM) et réaction (containment, remédiation) illustre la complémentarité des couches de défense dans une démarche de défense en profondeur.
À l’issue du parcours, l’étudiant est capable de : (1) analyser une menace et ses impacts potentiels ; (2) concevoir des règles de filtrage pertinentes en lien avec une architecture réseau donnée ; (3) mettre en place des stratégies de détection adaptées au contexte (signatures, seuils, modèles) ; (4) évaluer la robustesse d’un schéma d’authentification et renforcer les contrôles d’accès ; (5) documenter et auditer les décisions de sécurité pour améliorer en continu la posture globale.
Ce support s’adresse en priorité aux étudiants de Master/Ingénierie en informatique, réseaux ou systèmes, ainsi qu’aux professionnels souhaitant consolider leurs fondamentaux. Il peut servir de base à des travaux dirigés (analyse de journaux, élaboration de politiques de pare-feu, scénarios d’attaque/défense) et à des mini-projets (détection d’anomalies, implémentation de contrôles d’authentification avancés).
En synthèse, ce cours constitue un tronc commun efficace pour comprendre l’écosystème des menaces, structurer une défense en profondeur, et déployer des mécanismes fiables d’authentification et de surveillance. Il favorise une approche méthodique et documentée de la sécurité, indispensable pour évoluer vers des sujets plus avancés (cryptographie appliquée, sécurité applicative, forensique, réponse à incident, sécurité cloud).
3. Aperçu du document
Voir ou télécharger le document sur le site d’origine
Ce document est hébergé par une source externe. Nous ne revendiquons aucun droit sur son contenu. Pour toute demande de retrait, veuillez contacter l’auteur ou l’hébergeur officiel.