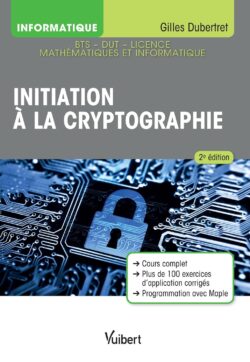1. A propos du cours
- Auteur : Cours rédigé par Delphine Boucher – notes prises par Téofil Adamski :contentReference[oaicite:0]{index=0}
- Type : Polycopié universitaire (Master 1), PDF, 32 pages, version du 9 avril 2021 :contentReference[oaicite:1]{index=1}
- Langue : Français
- Licence : Non spécifiée – diffusion pédagogique libre
2. Courte description du cours
Ce support de 32 pages initie à la théorie des codes correcteurs : codes linéaires, Hamming, Reed-Solomon, BCH, Goppa et cryptosystème de McEliece. Illustré d’exemples, d’algorithmes de décodage et d’exercices, il fournit les bases pour la fiabilité des transmissions numériques (≈ 240 caractères).
3. Longue description du cours
Contexte et objectifs. Destinées aux étudiants de Master 1 en mathématiques fondamentales de l’Université de Rennes 1, ces notes condensent un semestre d’enseignement sur la théorie algébrique du codage. L’enjeu principal : assurer la transmission fiable d’informations sur des canaux sujets au bruit, grâce à l’ajout de redondance contrôlée dans les messages. Le document alterne rappels algébriques, définitions formelles et applications concrètes en télécommunications et cryptographie.
Structure générale. Le cours est organisé en six chapitres progressifs :
- Chapitre 1 – Généralités. Présente la motivation historique, les notions d’alphabet, mots, distance de Hamming et établit les paramètres (n,k,d) caractérisant un code. Les codes linéaires y sont introduits ainsi que le principe de décodage par tableau standard et par syndrome.
- Chapitre 2 – Codes de Reed-Solomon et de Reed-Muller. Expose la construction des GRS, leur distance minimale optimale et leur décodage, puis décrit les codes de Reed-Muller, fondamentaux pour les applications spatiales.
- Chapitre 3 – Codes cycliques. Détaille la représentation polynomiale dans $\dfrac{\mathbf F_q[X]}{(X^n-1)}$, les notions de polynôme générateur et de contrôle ainsi que la factorisation de Xn − 1 sur Fq pour extraire des familles de codes performants.
- Chapitre 4 – Codes BCH. Introduit une famille paramétrable t-correctrice d’erreurs, énonce leurs propriétés et fournit l’algorithme de décodage de Berlekamp–Massey.
- Chapitre 5 – Codes de Goppa. Met l’accent sur les codes algébriques utilisés dans la cryptographie post-quantique ; présente leur construction via polynômes minimaux et prouve leurs bonnes performances difficiles à casser.
- Chapitre 6 – Cryptosystème de McEliece. Application directe : comment un code correcteur sert de noyau à un schéma à clef publique. Le cours détaille génération des clefs, chiffrement, déchiffrement et sécurité.
Méthodes pédagogiques. Chaque concept théorique est suivi d’un exemple numérique court (souvent sur F2) et d’exercices guidés : calcul de matrice de contrôle, simulation de bruit, correction d’erreurs. Des encarts « À retenir » récapitulent les formules clés ; les démonstrations essentielles sont mises en retrait pour ne pas interrompre le fil pratique.
Compétences acquises. À l’issue de la lecture, l’étudiant sait :
- Modéliser un canal bruyant par une distance métrologique et choisir un code adapté.
- Construire un code linéaire à l’aide de matrices génératrices et de contrôle.
- Implémenter un décodage par syndrome puis optimiser avec Berlekamp–Massey.
- Analyser les paramètres (n,k,d) et prouver l’optimalité de certains codes parfaits (Hamming, Golay).
- Expliquer le rôle des codes dans des protocoles de cryptographie (McEliece) et la sécurité post-quantique.
Public cible et pré-requis. Étudiants de mathématiques ou d’informatique ayant suivi un premier cours d’algèbre linéaire et connus de la théorie des corps finis. Les ingénieurs télécoms ou chercheurs en sécurité trouveront une passerelle rapide vers les applications pratiques.
Atouts éditoriaux. Mise en page aérée, numérotation fine des résultats, encadrés historiques (Hamming 1950, Reed & Solomon 1960) et figures illustrant la géométrie des codes dans l’espace de Hamming. Une bibliographie triée (MacWilliams–Sloane, Huffman–Pless) achève l’ouvrage et ouvre vers la littérature spécialisée.
4. Aperçu du document
Voir ou télécharger le document sur le site d’origine