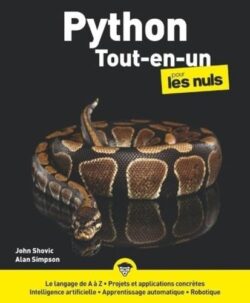1. A propos du cours
- Auteur : RAZAFIARISON Olivio Tojo Fandreseniaina
- Type : Mémoire académique de Licence, Parcours Réseaux et Systèmes (École Supérieure Polytechnique, Université d’Antananarivo)
- Langue : Français
- Licence : Non spécifiée explicitement ; à défaut, droits réservés à l’auteur et à l’établissement. Usage pédagogique recommandé avec mention de la source.
2. Courte description du cours
Ce mémoire présente une démarche complète d’automatisation de l’administration réseau : inventaires, templates de configuration, orchestration, supervision et sécurité. Objectif : fiabiliser les opérations, réduire la dérive et industrialiser les déploiements.
3. Longue description du cours
Ce mémoire propose une exploration structurée de l’automatisation appliquée à l’administration des réseaux informatiques, avec une méthodologie qui part des fondamentaux d’architecture pour aboutir à des pratiques opérationnelles reproductibles. L’auteur part d’un constat largement partagé : les opérations manuelles sur les équipements (commutateurs, routeurs, pare-feu, points d’accès) sont lentes, sujettes aux erreurs et difficiles à tracer à grande échelle. L’automatisation, adossée à des modèles déclaratifs et à l’Infrastructure as Code, fournit un cadre pour gagner en cohérence, en traçabilité et en sécurité.
Le document commence par rappeler les fondamentaux réseaux : plans de commutation et de routage, segmentation par VLAN, services d’infrastructure (adressage IP, DNS, DHCP, NTP, Syslog), politiques de QoS et filtrage. Cette base permet d’expliquer les limites des approches artisanales (saisies CLI ponctuelles, copier-coller), puis de justifier un basculement vers des workflows à forte valeur : normalisation des configurations, idempotence des changements, vérifications préalables et suivi post-déploiement.
La méthodologie proposée s’appuie sur quatre piliers :
1. la modélisation de l’état désiré (inventaires, rôles, variables, matrices de ports),
2. la génération par templates (par exemple via un moteur de gabarits) pour produire des configurations homogènes,
3. l’orchestration de l’application sur l’ensemble du parc avec gestion fine des dépendances,
4. le contrôle continu de la dérive entre l’état attendu et l’état courant. Chaque pilier est illustré par des cas d’usage concrets, de la configuration de base (bannières légales, accès administratifs, services de temps et de logs) au déploiement cohérent de VLAN sur des commutateurs d’accès et d’agrégation.
Le mémoire détaille ensuite les mécanismes de collecte et d’inventaire. En s’appuyant sur SSH et, selon les équipements, sur des interfaces API (REST, RESTCONF, NETCONF) ou SNMP, l’auteur décrit comment récupérer l’état des interfaces, des tables de routage, des versions logicielles ou des modules matériels. Ces inventaires deviennent des sources de vérité pilotant les templates et les règles d’orchestration. L’approche sépare la donnée (inventaires et variables) de la logique (rôles et tâches), ce qui facilite la maintenance et la réutilisation.
Un chapitre central expose les scénarios d’automatisation les plus fréquents :
– provisionnement initial d’équipements (nommage, gestion des accès, durcissement de la surface d’attaque, activation SSH, désactivation des services non nécessaires),
– déploiement coordonné de VLAN et de trunks sur un ensemble de commutateurs,
– configuration de protocoles de routage selon des patrons homogènes,
– application de politiques de sécurité (listes de contrôle, segmentation, journaux),
– mise en place d’outils de supervision (export de métriques et d’événements, seuils d’alerte, remontée d’indicateurs).
Pour chaque scénario, la démarche préconise une préparation en laboratoire, des tests de non-régression, puis un déploiement progressif avec fenêtres de maintenance et possibilité de rollback.
L’auteur met l’accent sur l’assurance qualité et la fiabilité. Avant toute application, les templates sont validés par des contrôles syntaxiques et sémantiques ; les commandes rendues sont comparées à des références ; les journaux d’exécution sont centralisés pour l’auditabilité. L’intégration dans des pipelines CI/CD est discutée : tests de rendu de configuration, tests de conformité, exécution en environnement de préproduction, puis promotion vers la production. Un contrôle de version systématique garantit la traçabilité, la revue par les pairs et la restauration de versions antérieures.
Le volet exploitation couvre les tâches récurrentes : sauvegarde et archivage des configurations, inventaires périodiques, mises à jour logicielles planifiées, collecte automatique d’artefacts en cas d’incident (états d’interfaces, statistiques d’erreurs, tables ARP/MAC). La supervision s’appuie sur des flux d’événements et de métriques pour déclencher des remédiations encadrées, par exemple l’isolation d’un segment défaillant ou la restauration d’une configuration de référence. L’objectif est d’obtenir un réseau plus résilient, où les opérations routinières sont déléguées à la machine et où l’expertise humaine se concentre sur la conception, l’analyse et l’amélioration continue.
Les aspects de sécurité sont traités de bout en bout : gestion des secrets, segmentation, réduction de la surface d’attaque, contrôle des accès administratifs, journalisation détaillée des changements, conservation horodatée des preuves. L’automatisation n’est pas seulement un gain de temps ; c’est aussi un moyen de rendre la conformité vérifiable et la gouvernance effective : définition des rôles, règles de validation, documentation intégrée aux pipelines.
Le mémoire insiste enfin sur les pré-requis et limites : qualité des inventaires, standardisation des modèles, compatibilité des équipements, formation des équipes, sponsoring managérial. L’adoption progressive est encouragée : commencer par des périmètres à faible risque, traiter les cas d’usage à forte valeur, mesurer les gains (temps d’exécution, taux d’erreur, cohérence de configuration), puis élargir. Parmi les perspectives d’évolution figurent la télémétrie en flux, la généralisation des API natives, la vérification formelle des politiques et l’alignement avec les approches SDN et cloud. Au total, le document constitue une base solide pour étudiants, enseignants et praticiens qui souhaitent introduire et pérenniser l’automatisation réseau dans des environnements hétérogènes, en s’assurant d’un haut niveau de qualité, de sécurité et de traçabilité.
4. Aperçu du document
Voir ou télécharger le document sur le site d’origine