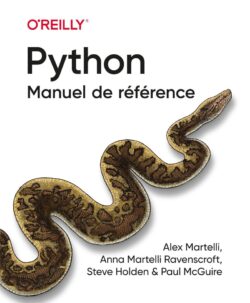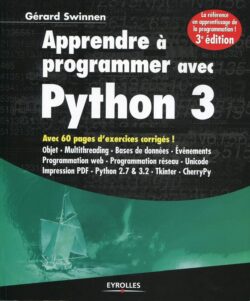1. A propos du cours
- Auteur : Baptiste Calmès
- Type : Notes de cours universitaires (10 pages, PDF)
- Langue : Français
- Licence : Non spécifiée – usage pédagogique
:contentReference[oaicite:0]{index=0}
2. Courte description du cours
Ce résumé de dix pages présente les notions de relation d’équivalence, de classes, d’ensemble quotient et montre comment transporter les lois de groupes et d’anneaux au quotient, illustrant la construction de ℤ/nℤ et le théorème de Lagrange.
3. Longue description du cours
Ces notes rédigées par Baptiste Calmès ouvrent le cours d’arithmétique et traitent de la notion clé de relation d’équivalence. Elles visent à fixer les définitions utiles pour les chapitres ultérieurs (congruences, théorème chinois, équations diophantiennes) et à initier l’étudiant au « passage au quotient », technique omniprésente de l’algèbre contemporaine.
Le document s’ouvre sur un rappel minutieux du vocabulaire de base. Après avoir rappelé qu’une relation sur un ensemble E est un sous-ensemble de E × E, l’auteur définit une relation d’équivalence comme étant réflexive, symétrique et transitive. Chaque propriété est illustrée par des exemples parlants : parallélisme de droites, similarité de triangles, fonctions égales sauf en un nombre fini de points. Inversement, des contre-exemples bien choisis montrent pourquoi un ordre total ou une relation de voisinage ne satisfont pas toutes les conditions. Cette alternance aide l’étudiant à cerner la portée exacte de la définition.
La seconde partie traite de la construction des classes d’équivalence. Calmès prouve que chaque élément appartient à une unique classe, que deux classes sont soit égales soit disjointes et que la famille de toutes les classes forme une partition de l’ensemble initial. Des exercices rapides invitent le lecteur à décrire les classes de congruence modulo 7 ou à déterminer le nombre de classes dans un groupe fini donné, renforçant ainsi la compréhension active des résultats théoriques.
La notion d’ensemble quotient — noté E/∼ — est alors introduite. Une carte conceptuelle montre la projection canonique π : E → E/∼ qui associe à chaque élément sa classe. L’auteur explique comment, en regroupant les éléments indiscernables, on simplifie l’étude des structures complexes tout en conservant l’information pertinente. Cette idée abstraite est illustrée par un schéma commutatif et par la description détaillée de plusieurs quotients d’ensembles concrets.
L’étude se poursuit par l’exemple emblématique des congruences dans ℤ. On démontre que la relation « x ≡ y mod n » est bien une relation d’équivalence et que l’ensemble quotient ℤ/nℤ représente l’ensemble des restes possibles de la division euclidienne par n. Les cas limites n = 0 (relation triviale) et n = 1 (relation grossière) sont discutés afin de montrer comment la théorie s’adapte aux situations extrêmes. La section se conclut sur un parallèle entre cette construction et les classes latérales dans un groupe plus général.
Une part substantielle du texte est consacrée au passage d’une loi de composition au quotient. Calmès énonce un critère général : une loi * sur E descend au quotient si elle est compatible avec la relation, c’est-à-dire si a ∼ b et c ∼ d impliquent a*c ∼ b*d. Cette compatibilité est ensuite exploitée pour deux cadres fondamentaux.
Dans la théorie des groupes, l’auteur rappelle le théorème de Lagrange, introduit les classes à droite gH et détaille la construction du groupe quotient G/H. Il souligne l’importance de cette opération pour comprendre la structure interne d’un groupe, identifier ses sous-groupes normaux et étudier ses représentations.
Dans la théorie des anneaux, on retrouve l’idéal principal (n) de ℤ et la construction du corps fini ℤ/pℤ lorsque p est premier. L’auteur montre comment les propriétés algébriques descendent naturellement au quotient, fournissant ainsi un premier exemple concret de corps fini, instrument indispensable en cryptographie et en codage.
Sur le plan éditorial, le document adopte une mise en page épurée : titres hiérarchisés, encadrés gris pour les définitions, marges annotées pour les remarques clés et schémas commutatifs centrés. Chaque démonstration suit la progression énoncé → idée clef → preuve détaillée, ce qui facilite la lecture autonome. Les dix pages se lisent ainsi comme un dialogue pédagogique plutôt que comme une succession de théorèmes arides.
Deux annexes finales rappellent les axiomes des groupes et des anneaux & corps, tandis qu’une liste d’exercices rapides permet au lecteur d’évaluer sa compréhension avant d’aborder les chapitres suivants du cours. Daté du , ce support constitue une ressource pédagogique fiable pour les étudiants de licence ou de classes préparatoires, posant les bases indispensables à l’arithmétique moderne et à l’algèbre abstraite.
4. Aperçu du document
Voir ou télécharger le document sur le site d’origine